
Les thumbnails et la propriété intellectuelle ont toujours entretenu des relations conflictuelles... Rappelons, si besoin est, qu’
un thumbnail (ou imagette en français) est la version réduite d’une image au format timbre-poste que l’on trouve le plus souvent dans des moteurs de recherche (par ex.
Google images) ou encore sur des sites de commerce électronique. Dès lors, il est évident que cette reproduction - certes en miniature mais tout de même intégrale - vient questionner les droits d’auteur dont l’une des prérogatives principales est justement le droit de reproduction.
C’est face à ce type de dilemme qu’une cour d’appel américaine du 9
e district a été confrontée dans l’affaire «
Perfect 10 vs Google ». En l’espèce,
Perfect 10, site pour adulte fournissant contre rémunération l’accès à des photographies de mannequins nues, avait engagé des poursuites contre Google au motif que la fonction « recherche d’images » du moteur de recherche violait ses droits d’auteur sur ses photographies. En effet, bien que l’accès à ces clichés soit payant, l
es internautes ont eu la possibilité de visionner ces photos au hasard de leurs recherches dans Google Images. En fait, à l’origine de ce référencement d’images se trouvaient des sites reproduisant illégalement les photographies des mannequins vers lesquels Google crée un lien automatique permettant d’afficher les images stockées sur ces serveurs tiers. Face à cette situation, Perfect 10 dénonça une violation de ses droits d’auteur par Google tant au regard de l’affichage des thumbnails qu’à celui de la reproduction illicites des photographies sur des sites tiers. En réponse, Google se prévalait de la jurisprudence «
Kelly vs Aribasoft » dans laquelle une cour d’appel avait considéré que les thumbnails utilisés par un autre moteur de recherche entraient dans le cadre du
fair use. Ce n’est pas pourtant la position qui fut retenue dans
une première injonction prononcée le 21 février 2006 dans l’affaire qui nous intéresse, dans laquelle le juge A. Howard Matz considéra qu’à l’inverse de l’affaire « Kelly vs Aribasoft », Google bénéficiait d’une rémunération indirecte grâce à la violation des droits d’auteur par des tiers, ces derniers diffusant des publicités via le programme AdSense de Google : «
Les thumbnails proposés par Google mènent directement l’internaute vers des sites rémunérant Google par la publicité ». Ainsi, sous ses airs d’intermédiaire innocent, Google profiterait de la contrefaçon des œuvres...
Pourtant, mercredi dernier, la cour d’appel qui a eu à se prononcer de nouveau sur cette affaire a pris le contre-pied de cette analyse. Plus exactement, les juges d’appel ont reproché à la première décision de ne pas avoir suffisamment motivé le refus d’application du «
fair use ». De manière tout à fait pédagogique, la cour d’appel rappelle que quatre critères permettent de rechercher si il y a ou non
fair use : l’objectif et les caractéristiques de l’utilisation de l’œuvre ; la nature de l’œuvre protégée ; la part de réutilisation de l’œuvre dans l’activité critiquée ; et enfin les conséquences de cette utilisation sur la valorisation et l’exploitation de l’œuvre protégée.
Sur le premier des critères, la cour d’appel a estimé que l’utilisation des photographies par Google à des fins entièrement étrangères à celles poursuivies par l’auteur justifie l’application du fair use : «
Si une image est créée initialement à des fins d’esthétique, de divertissement ou d’information, un moteur de recherche transforme celle-ci en un pointeur dirigeant l’internaute vers une source d’information ». Mais le point le plus important dans cette décision est sans aucun doute
l’affirmation des juges d’appel selon laquelle cette finalité étrangère au but poursuivi initialement par l’auteur prévaut sur toute incidence commerciale concernant l’exploitation de l’œuvre par l’auteur. Pour justifier une telle position, les juges d’appel ont déclaré que Perfect 10 devait en premier lieu prouver l’inapplicabilité du
fair use avant de se plaindre du préjudice commercial engendré par Google. Et surtout,
la cour d’appel souligne le bénéfice apporté aux internautes par la recherche d’images pour implicitement justifier l’atteinte au monopole de l’auteur sur son œuvre. Toutefois, la cour d’appel s’est révélée plus prudente sur d’autres points et notamment l’assistance que Google fournie indirectement dans la contrefaçon des œuvres. Ainsi, le moteur de recherche permet une diffusion plus large des reproductions illicites des œuvres et engage sa responsabilité en cas de conscience d’une telle aide qu’il apporte aux contrefacteurs.
Une nouvelle fois, le droit américain se distincte des systèmes juridiques continentaux en matière de droits d’auteur. Dans cette décision, la logique américaine qui veut que le droit d’auteur soit l’exception et la libre utilisation des œuvres le principe s’illustre parfaitement. A l’inverse, en droit français, le droit d’auteur demeure le principe et la libre utilisation des œuvres l’exception... au demeurant très encadrée ! Ainsi, il paraît inimaginable d’aboutir à une telle décision devant un tribunal de l’hexagone.
Au-delà du fait que la notion de fair use est totalement étrangère au droit français, Google devrait prouver que les thumbnails entrent dans l’une des exceptions prévues à l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle et qu’en outre cette exception satisfait le fameux triple test... Autant d’obstacles qui présagent d’une solution totalement opposée en cas de contentieux sur le sol français même si l'on peut s'interroger sur une possible application de l'exception d'information introduite par la loi du 1er août 2006. Le droit d’auteur et le copyright sont des cousins qui décidemment ne se ressemblent vraiment pas !...
 Lundi dernier, les autorités de Hong Kong ont annoncé la création d’une loi visant à punir les spammeurs d’amendes extrêmement sévères et même d’emprisonnement... Rappelons que si la Chine a bénéficié de la rétrocession de Hong Kong par les britanniques en 1997, cette cité a conservé une relative autonomie dans ses pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Dans l’affaire qui nous intéresse, la cité hongkongaise n’a pas lésiné dans l’utilisation de son pouvoir législatif. Ainsi, sous l’empire de la nouvelle loi, le fait d’envoyer du courrier indésirable sera puni d’une amende de 1 millions de Hong Kong dollars (soit environ 95000 euros) et/ou de 5 ans d’emprisonnement. En outre, le fait de s’introduire dans un système informatique à des fins commerciales portera la peine à 10 ans de prison ! L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif se fera en deux temps, la première étape étant prévue pour la fin de cette semaine selon Marion Lai, secrétaire au commerce, à l’industrie et aux technologies.
Lundi dernier, les autorités de Hong Kong ont annoncé la création d’une loi visant à punir les spammeurs d’amendes extrêmement sévères et même d’emprisonnement... Rappelons que si la Chine a bénéficié de la rétrocession de Hong Kong par les britanniques en 1997, cette cité a conservé une relative autonomie dans ses pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Dans l’affaire qui nous intéresse, la cité hongkongaise n’a pas lésiné dans l’utilisation de son pouvoir législatif. Ainsi, sous l’empire de la nouvelle loi, le fait d’envoyer du courrier indésirable sera puni d’une amende de 1 millions de Hong Kong dollars (soit environ 95000 euros) et/ou de 5 ans d’emprisonnement. En outre, le fait de s’introduire dans un système informatique à des fins commerciales portera la peine à 10 ans de prison ! L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif se fera en deux temps, la première étape étant prévue pour la fin de cette semaine selon Marion Lai, secrétaire au commerce, à l’industrie et aux technologies. La semaine dernière, les procureurs généraux américains de 8 Etats avaient enjoint au site communautaire
La semaine dernière, les procureurs généraux américains de 8 Etats avaient enjoint au site communautaire  C’est la question sur laquelle un juge britannique répondant au nom de
C’est la question sur laquelle un juge britannique répondant au nom de  Mieux vaut tard que jamais surtout lorsqu’il s’agit de sujets qui fâchent... Et l’audiovisuel en fait partie puisque étant un domaine avec lequel les Etats entretiennent des relations ambiguës et teintées de pulsions souverainistes... Ainsi, l’Union européenne a depuis longtemps été le théâtre d’oppositions frontales entre des conceptions bien différentes de la régulation des services de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, l’espace européen n’est pas dépourvu de toute coordination entre les Etats membres quant à la régulation de l’audiovisuel et ce, grâce à la célèbre directive n°
Mieux vaut tard que jamais surtout lorsqu’il s’agit de sujets qui fâchent... Et l’audiovisuel en fait partie puisque étant un domaine avec lequel les Etats entretiennent des relations ambiguës et teintées de pulsions souverainistes... Ainsi, l’Union européenne a depuis longtemps été le théâtre d’oppositions frontales entre des conceptions bien différentes de la régulation des services de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, l’espace européen n’est pas dépourvu de toute coordination entre les Etats membres quant à la régulation de l’audiovisuel et ce, grâce à la célèbre directive n° Toute initiative en matière de lutte contre le spam doit être accueillie comme un don du ciel, ces courriers indésirables représentant près de 40% de la totalité du trafic de mails sur l’année 2006 selon la «
Toute initiative en matière de lutte contre le spam doit être accueillie comme un don du ciel, ces courriers indésirables représentant près de 40% de la totalité du trafic de mails sur l’année 2006 selon la «  Les thumbnails et la propriété intellectuelle ont toujours entretenu des relations conflictuelles... Rappelons, si besoin est, qu’
Les thumbnails et la propriété intellectuelle ont toujours entretenu des relations conflictuelles... Rappelons, si besoin est, qu’ Si les attentats du 11 septembre 2001 ont eu des répercussions très profondes sur la géopolitique, ils ont aussi grandement bouleversé la physionomie de l’échange international de données personnelles. Un des points les plus frappants est le dossier
Si les attentats du 11 septembre 2001 ont eu des répercussions très profondes sur la géopolitique, ils ont aussi grandement bouleversé la physionomie de l’échange international de données personnelles. Un des points les plus frappants est le dossier  Décidément, l’Utah est devenu un véritable laboratoire des fausses bonnes idées en droit de l’internet !
Décidément, l’Utah est devenu un véritable laboratoire des fausses bonnes idées en droit de l’internet !  A l’heure où la pornographie infantile est le sujet le plus débattu par les juristes spécialistes de l’internet,
A l’heure où la pornographie infantile est le sujet le plus débattu par les juristes spécialistes de l’internet, 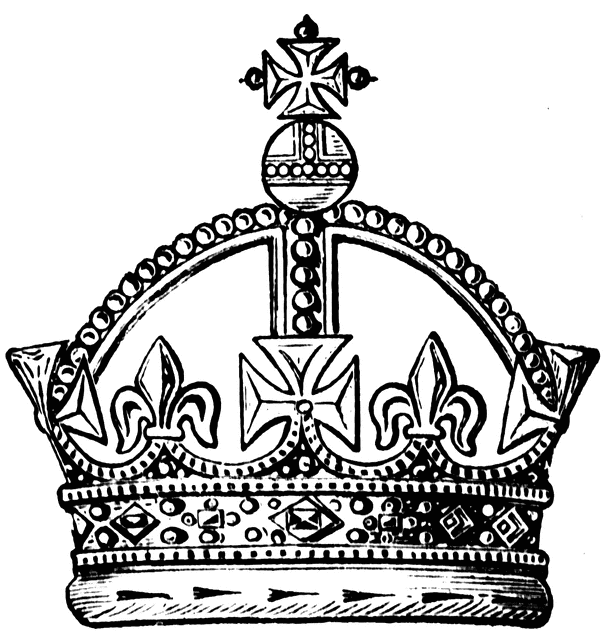 Après des attaques récurrentes pour contrefaçon, YouTube fait l’objet d’une plainte sur le fondement d’une infraction aujourd’hui disparue dans la plupart des systèmes juridiques occidentaux :
Après des attaques récurrentes pour contrefaçon, YouTube fait l’objet d’une plainte sur le fondement d’une infraction aujourd’hui disparue dans la plupart des systèmes juridiques occidentaux :  Au pays de l’
Au pays de l’ Hier,
Hier, 






 "
"





